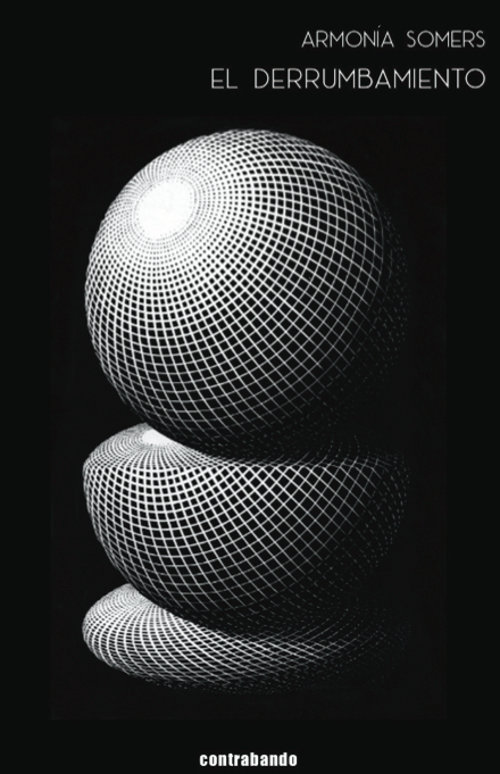Editorial HUM, Montevideo, 2021, 230 pages.
ISBN : 978-9915-653-97-6
Gustavo Espinosa est un écrivain uruguayen né en 1961 à Treinta y Tres, petite ville du nord-est du pays, sur les rives du rio Olimar et berceau du folklore national. Il est professeur de littérature dans le secondaire, critique, musicien, et auteur de plusieurs recueils de poésie et romans primés dans son pays. Il est aussi guitariste de rock et de blues. En 2001 il publie son premier roman « China es un frasco de fetos » (écrit dans les années 80) (une anti utopie sarcastique selon Mariana Pérez Balocchi) qui connait une diffusion limitée mais un vrai succès d’estime. « Carlota podrida » est couronné en Uruguay par le Prix National de Littérature en 2011. Primé à plusieurs reprises pour ses romans suivants, « Las aranas de Marte » (2011) puis « Todo termina aquì » (2016, prix Bartolomé Hidalgo), Gustavo Espinosa s'impose comme un auteur majeur en Uruguay. En 2018 « China es un frasco de fetos » est réédité en Argentine chez Alto Pogo. En 2020 trois de ses romans sont publiés en Espagne en un seul volume sous le titre « Trìptico de Treinta y Tres » aux éditions Contrabando (Valencia), et « Carlota podrida » est traduit en français pour les éditions Latinoir sous le titre « Pourquoi j’ai enlevé Charlotte Rampling ». « La galaxia Góngora » en 2021 est son cinquième roman, sans doute le plus audacieux à ce jour.
C’est le cinquième roman de Gustavo Espinosa en plus de vingt ans d’activité, et le plus audacieux dans la forme, car près d’un tiers du livre est en vers baroques inspirés des Solitudes du poète espagnol du Siècle d’Or, Luis de Góngora. Le Trapiche a déjà commenté les quatre romans précédents, on verra donc que je ne suis pas très objectif sur cet auteur, comme sur quelques autres uruguayens. D’autant plus que depuis lors, j’ai traduit et publié en français une de ses nouvelles dans une anthologie bilingue, puis un de ses romans sous le titre « Pourquoi j’ai enlevé Charlotte Rampling », aux éditions L’atinoir. Ce travail m’a permis d’améliorer ma compréhension de l’auteur et de me rendre compte qu’à la première lecture bien des choses m’avaient échappé. Espinosa n’est pas une lecture facile, mais c’est une lecture qui apporte souvent des moments de jubilation, car ce prof de littérature dans un lycée de province ne se prend jamais au sérieux, contrairement à son traducteur français.
Les romans écrits entièrement ou partiellement en vers sont plutôt rares, il faut des éditeurs courageux pour se risquer à les publier. Dans la littérature uruguayenne récente il me revient l’exemple de « Muerte y vida del sargento poeta », de Martin Bentancor (déjà commenté par le Trapiche). Dans la littérature française je me souviens, sans l’avoir lu, de « À la ligne », de Joseph Ponthus, couronné par plusieurs prix en 2019, et qui était écrit en vers libres.
Le livre d’Espinosa est en prose dans toute la première partie, soit deux bons tiers du total. Pourtant, même en prose, l’auteur ne tombe jamais dans la banalité ! Poursuivant ses expérimentations commencées dans le précédent roman, « Todo termina aquì », il joue sur différents registres pour narrer la genèse du texte gongorien. D’une part il pastiche une étude académique sur la vie et la formation intellectuelle de l’auteur, d’autre part, en alternant les chapitres, il nous plonge dans le récit de la vie d’un fermier uruguayen fuyant sa région d’origine après un incendie volontaire et une escroquerie à l’assurance, pour se réfugier à l’autre bout du pays. Comme dans « Todo termina aquì », il n’hésite pas à se mettre en scène lui-même avec quelques amis bien réels, comme des témoins ou des personnages secondaires de cette histoire.
On se trouve devant une œuvre dont la richesse et la complexité échappent à toute tentative de résumé. Essayons quand même !
L’histoire tourne autour d’Evergisto Richar Cuenca, un obscur poète originaire du village de Vergara, dans les rizières du nord-est uruguayen, issu d’une famille très modeste, qui fut étudiant à Montevideo au début des années 1980, sans arriver à obtenir de diplôme car ses difficultés économiques l’obligèrent à retourner chez lui. Après sa mort, on découvre qu’il a laissé un poème de deux mille vers gongoriens intitulé « La galaxia Góngora ». Il y a quelque chose des « Détectives sauvages » de Roberto Bolaño dans cette enquête sur Cuenca étudiant et ses amis dans l’Uruguay morose des dernières années de la dictature « civico-militaire » (1973-1985). C’est alors qu’il fait la connaissance d’autres jeunes gens qui partagent sa vocation littéraire, comme Gustavo Espinosa, Amir Hamed, Gustavo Alzugaray, Gustavo Verdesio, Sandino Nuñez, Lorena Narancio, qui existent tous dans notre réalité. Quant à Cuenca, il pourrait être un alter ego ou une excroissance détachée d’Espinosa lui-même, car ils ont en commun des origines géographiques et sociales, et des goûts littéraires, dont la fascination pour Góngora… Les mêmes personnages se retrouvent presque tous, mais avec des noms changés, et à une autre époque de leurs vies, dans le roman « Cién agujeros de gusano » de Gustavo Alzugaray, déjà commenté par le Trapiche.
Dans les chapitres impairs, Espinosa laisse libre cours à son humour décapant, non dénué d’empathie et de nostalgie, pour raconter leur vie d’étudiants (période qu’il évoque aussi dans « Fenimore y su Blime », la nouvelle traduite pour « Autres histoires d’Uruguay » chez L’atinoir) et leurs débuts littéraires, en commençant par une première rencontre mouvementée dans une salle d’examens. Le récit prend la forme de témoignages des divers acteurs, ou d’articles critiques : « es un texto muy difìcil de contextualizar en cualquier territorializaciòn, recorte generacional o ismo de aquellos que segmentan una instituciòn no demasiado compleja como la poesìa uruguaya. » et encore « En literatura, la singularidad del monstruo, la mutaciòn aparecida al margen de los protocolos previsibles de la evoluciòn, suele producir -paradojicamente- la invisibilidad de una obra… ». Pas de quartier dans l’ironie : « una editorial independiente de las que han surgido en estos dìas con un entusiasmo anàlogo al de las cervecerìas artesanales ». J’ai corné tant de pages dans le livre que je pourrais remplir des paragraphes entiers de citations !
Dans les chapitres pairs le personnage principal n’est plus E.R. Cuenca mais un certain Juan Rollfinke, éleveur ruiné de la région de Nueva Helvecia à l’ouest de Montevideo. Pour escroquer son assurance il met le feu à sa ferme puis s’enfuit avec sa famille dans une vieille Ford surchargé. Avec son épouse et sa fille Lucìa, adolescente révoltée et enceinte qui ne veut pas dire qui est le père, il va se cacher et refaire sa vie à l’autre bout du pays, à Vergara, oui, le village d’origine de Cuenca. Le lien chronologique entre les deux fils narratifs se fait à travers un épisode historique, la « rupture de la tablette » (26 novembre 1982), un dispositif régulant la parité entre dollar et peso qui ne résista pas à la réalité économique. Cet évènement précipite la ruine de Rollfinke et celle de Cuenca. Espinosa raconte d’une façon très amusante comment l’esprit limité de Rollfinke se représente cette « rupture de la tablette » comme un fait matériel dont il a du mal à comprendre l’effet sur sa vie, alors qu’il est par ailleurs partisan du gouvernement autoritaire de l’époque. Là-dessus se greffe l’histoire de « Cabeza de Mondongo » un assassin originaire lui aussi de Vergara, emprisonné au début de l’histoire, qui bénéficiera d’une amnistie au moment où la dictature arrivant à sa fin relâche de nombreux prisonniers politiques du mouvement tupamaro, au grand dam de Rollfinke et ses proches. Il y aura une fin très noire et tragique.
Les deux narrations convergent vers ce village de Vergara où Cuenca va rencontrer Lucìa, et où naîtra la fille de celle-ci, tandis que Rollfinke se consacre à la contrebande avec le Brésil en passant par la ville frontière de Yaguaròn. On est là en plein dans le terroir littéraire d’Espinosa, entre Treinte y Tres et le Brésil, comme dans « Todo termina aquì » où un chapitre essentiel se situe à Acegua, autre ville frontière. Après cinq romans il y aurait peut-être matière à réaliser un atlas.
Mais Espinosa est bien plus qu’un auteur de terroir, c’est aussi un homme à la culture immense, comme en témoigne son pastiche de critique littéraire académique dans les chapitres pairs, toujours avec une touche de dérision. Au passage on verra qu’il a aussi une sacrée culture littéraire française, bien qu’il ne parle pas la langue, il connaît nos classiques, de Flaubert à Moebius.
Pour le plaisir, encore une citation : «Los escritores y sus satélites (crìticos, reseñistas, editores) suelen relacionarse mediante el desdén. Los concursos literarios, màs que otras instituciones, concentran el desprecio rumoreado en vernisages y pubs, voceado e impreso en separatas culturales que terminan en una feria vecinal, envolviendo grandes bananas del Ecuador, sin que una pupila humana se haya detenido jamàs a acariciar el veneno de sus adverbios.». C’est ainsi que le premier opus du poète E.R. Cuenca, un recueil de poésie érotique très osé gagne un concours sous le titre « Labios mayores » (Grandes lèvres). Mais à partir de ce moment, l’auteur va vivre dans la hantise d’avoir attiré l’attention de la censure et des forces de répressions, d’être emprisonné et torturé. Il tombe dans un oubli presque complet après avoir cessé d’écrire et quitté la capitale. C’est des années plus tard, après des évènements auxquels le tueur « Cabeza de Mondongo » est mêlé, et la mort de Cuenca, que ses anciens amis apprennent qu’il a laissé ce long poème « La galaxia Góngora ».
Le lecteur se trouve alors devant ce « monstre », la dernière partie du livre, presque deux mille vers baroques, dont le contenu général a été révélé dès la première page du roman. Alors pourquoi les lire ? Ce n’est plus dans les habitudes du lecteur moyen ! Pour ma part, dans mes années de licence d’espagnol, j’ai été initié davantage à Baltasar Graciàn qu’à Luis de Góngora. Chaque prof a ses lubies, et les étudiants doivent bien s’y conformer. Au seuil de cette lecture j’ai donc fait quelques recherches sur internet et j’ai trouvé une citation de Lorca disant que les vers gongoriens s’étudient plus qu’ils ne se lisent. Pour rafraîchir ma mémoire j’ai parcouru en diagonale une version originale des Solitudes disponible en ligne. Et puis je me suis lancé !
Espinosa s’est livré à un exercice de virtuosité dont lui seul était capable, non seulement en Uruguay, mais peut-être même au monde. Je n’ai sans doute pas la culture nécessaire pour avoir tout compris, mais il faut lui tirer son chapeau. Il réussit le tour de force d’écrire ces vers alambiqués et truffés d’allusions aux classique de l’Antiquité et du Siècle d’Or (mais également aux années 1900 en Uruguay) pour raconter une histoire où se mêlent la réalité la plus vulgaire de l’Uruguay profond et rural, les machines agricoles rouillées, les motos chinoises, les chaussures de sport arrivées de Shangaï à pleins conteneurs (autant d’éléments omniprésents dans ses autres romans) et des évènement relevant du fantastique ou de la science-fiction la plus débridée. Même si certains passages sont ardus, le sarcasme est toujours là : je ne m’attendais pas à rire autant en lisant des vers gongoriens !
Dans une interview récente, Gustavo Espinosa invite toute personne qui voudrait écrire des romans à lire d’abord de la poésie. Une discipline qu’il s’impose manifestement lui-même. Ce livre paru en 2021 marque déjà de son influence la littérature uruguayenne, ayant inspiré (très librement) en 2022 un spectacle de la dramaturge Sandra Massera qui a été présenté en Espagne au festival d’Almagro.
/image%2F1282731%2F20240412%2Fob_9f5baf_apibt6wlk-01401.jpg)
/image%2F1282731%2F20240412%2Fob_9a4b04_unnamed.jpg)



/image%2F1282731%2F20240412%2Fob_da9af2_tapa-frente-colores-peligrosos.jpg)
/image%2F1282731%2F20240412%2Fob_303065_298785-d7b85edcd556491e888e29f0f67f8e3.jpg)
/image%2F1282731%2F20240412%2Fob_547aa2_img-4178.jpg)
/image%2F1282731%2F20240411%2Fob_4f879d_papeles-suizos-de-jose-arenas.jpg)
/image%2F1282731%2F20240411%2Fob_744813_851788.jpg)