"Arena" , de Lalo Barrubia (par Antonio Borrell)
Editorial Criatura, Montevideo, 2017, 190 pages.
ISBN : 978-9974-8634-9-1
Lalo Barrubia (la loba rubia) est le nom de plume et de scène de María Del Rosario González, romancière, poète, traductrice et « performeuse », née à Montevideo en 1967, et vivant à Malmö, en Suède, depuis 2001. Elle y est animatrice culturelle pour la jeunesse. Sans être en rupture avec son pays d’origine, elle se considère aussi chez elle en Suède, cultive son bilingüisme et estime faire partie des « auteurs suédois écrivant en langues non-scandinaves ». Elle dit écrire pour témoigner et garder une trace pour l’histoire de sa génération, celle qui avait dix-huit ou vingt ans à la fin des douze années de dictature (1973-1985). Elle qui considère que la musique est sa principale influence littéraire, a écrit plusieurs recueils de poésie et de nouvelles, ainsi que des romans : « Arena » (2003 et 2017) , « Ratas » (2012) a reçu le prix national de littérature en 2014. « Pégame que me gusta » (2009 et 2014) et « Los misterios dolorosos » (2013).
« Sex and drugs and rock’n roll » de Ian Dury pourrait être la bande-son de ce livre, qui fait aussi penser à Kerouac et parfois à Bolaño.
« Arena » (Sable) brosse le portrait d’une jeunesse uruguayenne rescapée et déboussolée à la sortie de la dictature militaire, dans la seconde moitié des années 1980, entre sexe, drogues et rock’n roll, mais aussi alcool, auto-stop, et plages de la côte atlantique, à la recherche de champignons hallucinogènes dans les pinèdes derrière les dunes. La première phrase du livre suffit à donner le ton : « Se despertó medio que demasiado temprano para la borrachera que traía de la noche anterior. Cuando tomaba coca nunca lograba dormir lo suficiente »
La construction du récit est à l’image de la vie des personnages: fragmentaire, erratique, centrée à tour de rôle sur divers protagonistes, tantôt à la troisième personne, tantôt à la première, le récit souvent cru ne manque pourtant pas de moments de poésie. Le narrateur des fragments écrits à la première personne est un homme, bien que l’auteur soit une femme, ce qui tord le cou, s’il le fallait encore, à l’idée bizarre selon laquelle il y aurait des écritures « masculines » et « féminines ».
Le fil conducteur du roman est l’histoire de « Pepe », le narrateur, journaliste débutant, en couple avec Patricia, une enseignante. Souhaitant écrire un article sur ce milieu de marginaux, (punks, rastas, rockers, hippies, paumés, dealers, routards) il va être complètement l’absorbé par celui-ci à cause de sa passion pour « La Potro », une jeune femme libre, infidèle et vagabonde. « Yo lo veìa todo como material literario, carne para una novela, carne jugosa ». La plupart personnages n’ont que des surnoms : Bayo 10, Pachuli, Zulù, Mìstico, la Sole, Matius, el Turupì, des identités qui, à l’image de leurs vies ne rentrent pas dans les normes. Des vies presque sans attaches, (à part peut être le numéro de téléphone d’une mère à Montevideo) entres fêtes et beuveries nocturnes sur les plages…
Il y a presque quelque chose de post-apocalyptique dans la vie de ces jeunes gens, qui souvent fuient la ville pour vivre comme des Robinsons, des naufragés, sur les dunes et les plages de la région de Rocha, le littoral atlantique, jusqu’à Chuy, la frontière brésilienne, lieu de tous les trafics. Et s’ils rêvent de partir au Brésil, c’est encore pour la défonce, pour fumer à longueur de journée: « Pasamos un rato hablando de drogas, cosa que siempre hacen los que no tienen drogas ni pueden hablar de nada cuando no tienen drogas, y escuchando un casete de Kortatu… »
La fin de la dictature signifie aussi le retour des exilés, l’arrivée d’étrangers, provocant l’incompréhension de ceux qui n’avaient pas pu partir : « Mientras todos soñábamos con irnos del pais había un montón de gente que llegaba. No entendíamos muy bien a qué volvían pero estábamos encantados de conocerlos, se lo decimos de corazón. Mucho gusto. Por favor contame còmo es Europa. Todo ese mambo del gran viejo mundo. »
Un des points forts de l’écriture de Lalo Barrubia est sa poésie, même quand il s’agit de raconter des épisodes triviaux. La première page de la seconde partie est à ce titre particulièrement réussie, en voici quelques lignes, un portrait de « La Potro » :
« No es su silueta ni sus piernas largas, no es el pelo ni el color de sus ojos, ni sus labios gruesos y pálidos, ni sus manos. No es su voz profunda ni sus huecos ni sus pechos infantiles. Es todo, todo su cuerpo y hasta el aire que arrastra cuando se mueve. Ella es su cuerpo, así como es, cansado y hermoso, curtido, extenso. Camina como quien camina mucho; coge como quien coge mucho; se emociona como quien tiene sed y toma agua. Es su cara como pómulos y dientes y malhumores. Es la prueba de lo perecedero, el fruto de la tierra, el dolor de veinte siglos, y el sabor de una piel. Es una mujer envolviendo una pierna en la otra sobre el asiento duro de un vagón de segunda clase, el viento en la cara, la nariz en el campo que se esfuma. Es una despedida ritual un treinta de diciembre. El abrazo final con la adolescencia de colarse de un lado para otro. Una muerte como cualquiera. Lleva toda la tarde saltando por trenes vacíos sin saber a donde va, no tiene a donde ir, no tiene necesidad de ir a alguna parte, solo moverse, bailar, oír la música. Vio pasar calles y pastos y túneles sin grafitis, y campos con vacas y mares de piedra. Solo ver y oír. La pantalla de televisión de un pais està por apagarse. Una mujer y un tren. Y me cuelgo del recuerdo que no tengo. Y me da bronca no haberla perseguido como hubiera hecho ella con su cámara de fotos. Y me da bronca no habérmela cogido en el baño de un tren. »
L’autre dimension poétique de cette écriture vient de la présence de la nature, souvent dans une sensation de communion, et l’évocation de lieux sauvages, devenus aujourd’hui très touristiques, comme Cabo Polonio ou Valizas (dont se souvient aussi l’argentin Pedro Mairal dans son récent roman « La Uruguaya »). Lalo Barrubia n’oublie pas qu’elle est poète quand elle écrit un roman : « Nos divertimos en verano y en invierno nos queremos morir. Pero no entonces. Entonces solo caminaba por la orilla y me bebìa la sal y el estruendo brillante de la espuma y el olor del verano. » Ou bien encore : « Vagué por un interminable desierto de arena. Un interminable desierto de arena. Un interminable desierto de arena. Un interminable desierto de arena. Busqué mi lìnea fugante, blanca, en la arena negra de la noche. Encontré mis propios ojos vaciados en el cielo negro, corriendo como agua entre las estrellas que formaban diseños mòviles y trazos repentinos y se expendían y se multiplicaban. Vi muchas màs estrellas de las que nadie ha visto nunca, abrazando la luna creciente y blanca. »
A cette époque en Uruguay, c’est le retour à la démocratie, et pourtant quand nos marginaux ont la mauvaise idée de s’aventurer à Punta del Este, station balnéaire très chic, la récente dictature se rappelle à leur souvenir à travers le comportement de la police qui les arrête et les expulse du lieu en raison de leur apparence minable et parce que certains garçons portent des boucles d’oreilles. (Et même sans vouloir toujours tout ramener à Albert Cossery, on ne peut s’empêcher de penser à « La violence et la dérision »)
Puis c’est l’hiver et le retour à Montevideo, toutes les ruses et astuces de La Potro pour survivre en volant dans les magasins, ou en faisant les fins de marché, surtout celui du dimanche, rue Tristàn Narvaja, une institution de la débrouille uruguayenne qui survit à toutes les crises économiques. De nouvelle réminiscences des années de dictature apparaissent à travers les souvenirs de certains personnages qui ont vécu, avec des yeux et des mentalités d’enfants confiés à des grand-mères, les absences et la clandestinité de parents parfois emprisonnés, ou exilés, ou « disparus »… Pour chacun des ces personnages viendra le moment de faire des choix, ou de subir ceux des autres…
Le Trapiche a déjà rendu compte par le passé d’un roman uruguayen évoquant la même époque et les mêmes milieux, « Adios Diomedes » de Leandro Delgado (publié en 2004 un an après « Arena ») mais avec Lalo Barrubia on est un cran au-dessus dans l’écriture, même si les deux lectures sont complémentaires. On pourrait y ajouter une troisième proposition de lecture, pour changer de pays mais pas d’époque, ce serait « Generaciòn Cochebomba » du péruvien Martin Roldàn Ruiz, qui nous plonge aussi dans les années 85-87 et dans la vie d’une jeunesse malmenée par le terrorisme et la répression, se réfugiant dans le rock, les drogues et la marginalité…

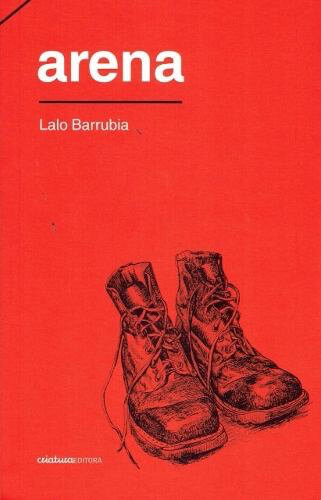



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F33%2F43%2F1454113%2F134459259_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F24%2F17%2F1454113%2F134262861_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F09%2F63%2F1454113%2F134205601_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F31%2F43%2F1454113%2F134009281_o.png)